8 Mai 1945 – 2025 : De la victoire partagée à la fracture des alliances
- Erick Mormin

- May 8, 2025
- 4 min read
Par Erick Mormin
Auteur et entrepreneur martiniquais, Erick Mormin explore les croisements entre technologie, culture et géopolitique. Gérant d’EKM Conseils / ekm972 – ekm Store, il est spécialiste en transformation numérique et enseigne les réseaux et la cybersécurité. Ses ouvrages techniques comme L’Évolution des Réseaux : De la Théorie à la Pratique et Introduction à la Programmation en C++ témoignent de son engagement pédagogique. Son écriture, à la fois littéraire et analytique, s’étend aussi à des réflexions sur notre monde en mutation, comme en témoigne cette tribune sur les fractures géopolitiques contemporaines.
Le 8 mai 1945 reste un jour de mémoire et de reconnaissance : la capitulation de l’Allemagne nazie marque la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Une victoire obtenue grâce à une coalition inédite d’Alliés — États-Unis, Royaume-Uni, URSS, France libre — unis face à la barbarie nazie. En 2025, 80 ans plus tard, cette unité semble lointaine. Les anciens alliés d’hier sont parfois devenus des adversaires d’aujourd’hui, et l’équilibre géopolitique mondial se redessine.
La Russie, d’alliée à adversaire ?
En 1945, l’Union soviétique était l’un des piliers de la victoire contre le nazisme. C’est un fait souvent occulté en Europe de l’Ouest, mais le peuple soviétique a payé un prix effroyable, avec près de 27 millions de morts. Pourtant, la mémoire commune s’effrite à mesure que les réalités géopolitiques évoluent.
Le pouvoir russe actuel instrumentalise cette mémoire de la “Grande Guerre patriotique” à des fins politiques internes et externes. Vladimir Poutine n’hésite pas à établir des parallèles fallacieux entre la lutte contre le nazisme et ses opérations en Ukraine, allant jusqu’à qualifier le gouvernement ukrainien de “néonazi” pour justifier son invasion. Cette distorsion de l’histoire sert un récit national où la Russie se présente comme rempart contre un Occident hostile, tout en légitimant ses ambitions territoriales.
Depuis l’annexion de la Crimée en 2014, puis l’invasion de l’Ukraine en 2022, la Russie s’est fermement positionnée contre l’Europe et l’OTAN, assumant une posture d’opposition et de défi. Les relations actuelles ne laissent plus place à l’ambiguïté : les ponts sont rompus. Moscou ne se voit plus comme un partenaire de l’Europe, mais comme le porte-voix d’un monde alternatif, multipolaire, où l’Occident serait en déclin. L’ancien allié est aujourd’hui perçu comme une menace stratégique directe.
Les États-Unis, alliés toujours fiables ?
L’Amérique, quant à elle, demeure officiellement le grand partenaire de l’Europe. Par le biais de l’OTAN, du G7 et d’accords économiques, les liens sont solides. Mais l’époque actuelle est marquée par une montée des incertitudes.
Ce qui relevait de la spéculation est devenu réalité : Donald Trump a retrouvé la Maison-Blanche en janvier 2025, ravivant les inquiétudes européennes. Ses premiers mois de mandat confirment les craintes d’un virage isolationniste américain. Son administration a déjà remis en question plusieurs engagements militaires à l’étranger et réduit significativement l’aide américaine à l’Ukraine. Ses pressions sur les membres européens de l’OTAN pour augmenter leurs dépenses militaires se sont intensifiées, accompagnées de menaces à peine voilées de réduire le parapluie sécuritaire américain.
Sa politique « America First » s’incarne désormais dans des décisions concrètes qui fragilisent une alliance pourtant historique. Cette nouvelle donne américaine contraint l’Europe à reconsidérer en profondeur sa dépendance stratégique.
Quelle souveraineté stratégique pour l’Europe ?
Face à ces bouleversements, l’Europe est confrontée à une question centrale : peut-elle encore dépendre des États-Unis pour sa défense ? L’Union européenne peine à parler d’une seule voix sur les sujets géopolitiques, mais les événements récents rendent indispensable une réflexion sur sa souveraineté stratégique.
Des initiatives concrètes émergent pourtant. Le Fonds européen de défense, doté de 8 milliards d’euros pour la période 2021-2027, finance désormais plusieurs programmes d’armement communautaires. La Coopération structurée permanente (CSP) a permis le lancement de plus de 60 projets collaboratifs entre États membres. Le programme SCAF (Système de Combat Aérien du Futur), bien qu’encore ralenti par des désaccords industriels, représente une ambition partagée entre la France, l’Allemagne et l’Espagne. Plus récemment, le projet “EU Sky Shield”, lancé fin 2023, vise à créer un bouclier antimissile européen intégré.
La crise énergétique consécutive à la guerre en Ukraine a également accéléré la diversification des approvisionnements et le développement des énergies renouvelables, réduisant progressivement la dépendance au gaz russe. Sur le plan numérique, l’Europe affirme sa souveraineté à travers le RGPD et des investissements massifs dans les technologies critiques comme les semi-conducteurs ou l’intelligence artificielle.
L’Europe doit pouvoir défendre ses intérêts, assumer ses choix diplomatiques et, le cas échéant, faire face seule à des crises majeures. Ce n’est pas une rupture avec les alliances passées, mais une adaptation lucide à un monde incertain.
Le 8 mai 1945 fut un moment d’unité exceptionnelle. Mais l’Histoire n’est pas figée. Elle nous enseigne que les alliances sont des constructions humaines, mouvantes, soumises aux vents des intérêts politiques. À l’heure où la Russie s’oppose à l’Europe, où l’Amérique se replie sous l’administration Trump, l’Europe doit trouver sa propre voie. Une voie autonome, responsable, tournée vers la paix, mais lucide sur les rapports de force.





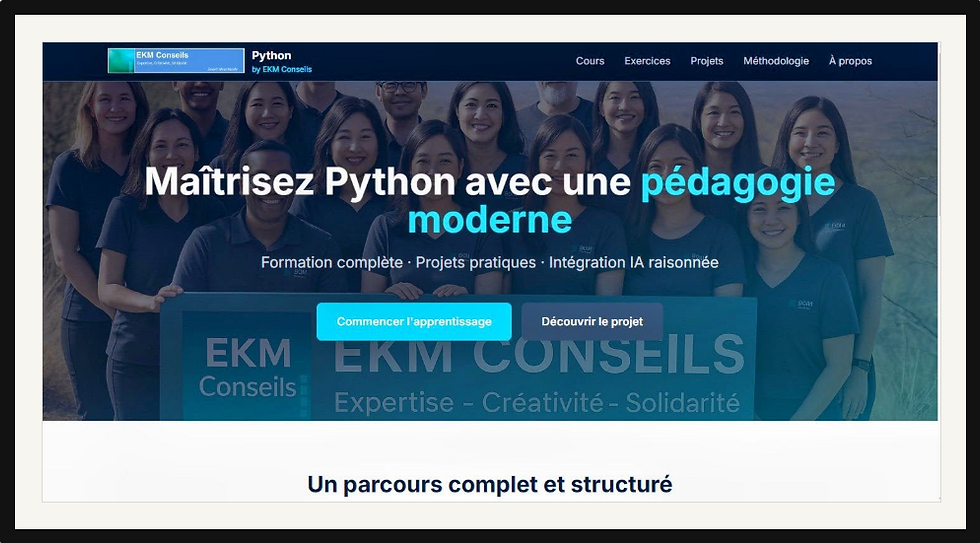
Comments