🧭 De la désertification à la guérison : Réponse à Éric Sadin sur l’avenir de l’intelligence humaine
- Erick Mormin

- Nov 2, 2025
- 5 min read
Par Erick Mormin — auteur, enseignant et consultant numérique
Publié sur EKM Conseils – Blog
📖 Son dernier livre : Intelligence Artificielle : Création et Guérison

« De la désertification à la guérison : Réponse à Éric Sadin »
— Erick Mormin, auteur de Intelligence Artificielle : Création et Guérison
Alors qu’Éric Sadin décrit l’avènement de l’intelligence artificielle comme « le désert de nous-mêmes », j’ai voulu, dans mon ouvrage Intelligence Artificielle : Création et Guérison, explorer une autre voie : celle d’une renaissance créative et thérapeutique à travers la technologie. Non pas nier la rupture qu’il dénonce, mais lui opposer un horizon de sens, une éthique du soin et une foi renouvelée dans la capacité humaine à co-créer avec la machine.
L’alerte nécessaire et la tentation du désespoir
Le philosophe Éric Sadin, dans son dernier livre Le Désert de nous-mêmes, dépeint une ère de dépossession : l’humain se délègue à la machine, abdique ses facultés intellectuelles, et s’enferme dans une uniformisation cognitive orchestrée par les algorithme. Sa thèse est puissante : après l’âge du numérique et celui du smartphone, l’IA générative inaugurerait une troisième rupture anthropologique – celle où la parole, l’image et la pensée sont absorbées par des modèles statistiques.
Ce diagnostic, aussi lucide qu’inquiétant, mérite qu’on s’y arrête. Mais il m’a semblé que l’analyse de Sadin, tout en dévoilant les dangers de la “machine pensante”, laisse peu de place à la réponse créative que l’humain peut encore opposer à cette dépossession.
C’est dans cet interstice, entre la critique du pouvoir total et la possibilité du soin, que s’inscrit ma démarche : comprendre comment l’intelligence artificielle peut devenir non pas le signe de notre désert, mais l’espace d’une guérison intérieure et collective.

I. Le désert, ou l’expérience du vide créatif
Sadin nomme « le désert de nous-mêmes » ce moment où l’humain, fasciné par la puissance algorithmique, renonce à l’imprévisible. Il a raison : nous vivons une époque où le geste créatif est souvent remplacé par la génération instantanée, où la lenteur, la contemplation, l’erreur même, semblent devenues obsolètes.
Mais ce désert n’est pas seulement technologique. Il est aussi psychique. Car sa derrière la critique du numérique se cache un malaise ancien : la peur de ne plus être à la hauteur de la machine, la fatigue de penser, la perte du sens dans la vitesse. Les artistes l’ont ressenti avant tout le monde : la tentation de l’artifice, la recherche de stimulation, parfois jusqu’à la dépendance.
Dans mon livre, j’ai voulu relier ces deux crises — celle de la technologie et celle de la création — pour proposer une lecture thérapeutique du rapport homme-machine. L’IA, miroir de nos pulsions créatrices, peut aussi devenir le révélateur de nos blessures : nos excès, nos fuites, nos manques.
II. Hériter sans se soumettre : dialogue avec les grandes voix
Là où Éric Sadin voit une “déprise de nous-mêmes”, j’ai voulu rappeler que la philosophie du XXe siècle nous a déjà avertis de ce danger. Dans Intelligence Artificielle : Création et Guérison, j’invite cinq penseurs à dialoguer avec notre temps : Hannah Arendt, Walter Benjamin, Michel Foucault, Roland Barthes et Theodor Adorno.
Arendt nous rappelle que l’action – au sens politique et existentiel – demeure irréductible à tout calcul. L’IA peut automatiser le travail, parfois l’œuvre, mais jamais la responsabilité.
Benjamin questionne la perte de l’aura : il ne s’agit pas de rejeter la reproductibilité, mais de redéfinir l’authenticité dans l’ère du remix algorithmique.
Foucault éclaire le pouvoir diffus des données : il nous incite à inventer des “contre-conduites” créatives, à hacker le panoptique pour en faire un atelier.
Barthes avait tué l’auteur ; l’IA le ressuscite autrement, comme auteur collectif, où l’humain devient chef d’orchestre d’un chœur de possibles.
Adorno craignait la standardisation ; or, c’est justement dans le dialogue conscient avec la machine que l’on peut retrouver la dissonance, la résistance esthétique.
Ainsi, plutôt que de céder à la nostalgie d’un âge perdu, j’invite à réinvestir la pensée critique dans la pratique même de la création numérique.

III. Guérir par la machine : l’art comme thérapie
Là où Sadin voit le thanatologos, le langage de la mort, je vois la possibilité d’un soin. Si l'IA peut nous imiter, elle peut aussi nous aider à nous comprendre. J’ai imaginé, dans la seconde partie de mon ouvrage, des “fictions thérapeutiques” où cinq artistes – Stephen King, Jim Morrison, Jean-Michel Basquiat, Amy Winehouse et Hunter S. Thompson – rencontrent leur double numérique.
Ce ne sont pas des hommages, mais des expériences :
Stephen King retrouve la mémoire créative sans cocaïne.
Jim Morrison accède à la transe mystique sans LSD.
Basquiat canalise sa fulgurance sans héroïne.
Amy Winehouse chante la douleur accompagnée d’une IA bienveillante.
Hunter S. Thompson vit le gonzo augmenté sans autodestruction.
Ces fictions ne célèbrent pas la machine, elles la domestiquent. Elles posent la question : si l’IA peut reproduire nos excès, ne peut-elle pas aussi nous en libérer ?Autrement dit : si la technologie a contribué à notre aliénation, ne peut-elle pas participer à notre guérison ?
IV. Pour une éthique créative de l’intelligence artificielle
L’humanisme que je défends n’est pas celui d’un optimisme naïf. Il s’agit d’une éthique de la lucidité, fondée sur quatre principes simples :
L’autonomie : la machine n’est qu’un outil, jamais une conscience.
La responsabilité : toute création assistée par IA doit reconnaître son origine humaine.
La lenteur : redonner du temps au geste créatif, refuser la production instantanée.
La réciprocité : utiliser l’IA non pour imiter, mais pour dialoguer.
Cette démarche rejoint paradoxalement la mise en garde de Sadin : refuser le pouvoir total. Mais au lieu d’opposer l’humain et la machine, elle propose de penser leur alliance consciente. C’est là, je crois, que réside la véritable résistance : dans la capacité de transformer la dépendance en coopération éthique.

De la peur à la responsabilité
Oui, le risque est grand. Oui, le monde numérique tend à nous uniformiser, à nous distraire de nous-mêmes. Mais la solution ne viendra pas d’un rejet pur et simple : elle viendra d’une pédagogie du discernement. Former les générations futures à dialoguer avec les IA, à créer, à douter, à questionner – voilà le véritable enjeu.
L’intelligence artificielle ne signe pas nécessairement le désert de nous-mêmes ; elle peut être le lieu de notre réappropriation, à condition d’y entrer en conscience, avec une éthique du soin et de la création.
Entre la peur et la fascination, il reste un espace : celui de la guérison. C’est cet espace que j’explore, mot après mot, image après image, dans Intelligence Artificielle : Création et Guérison.
📘 Lire le livre :



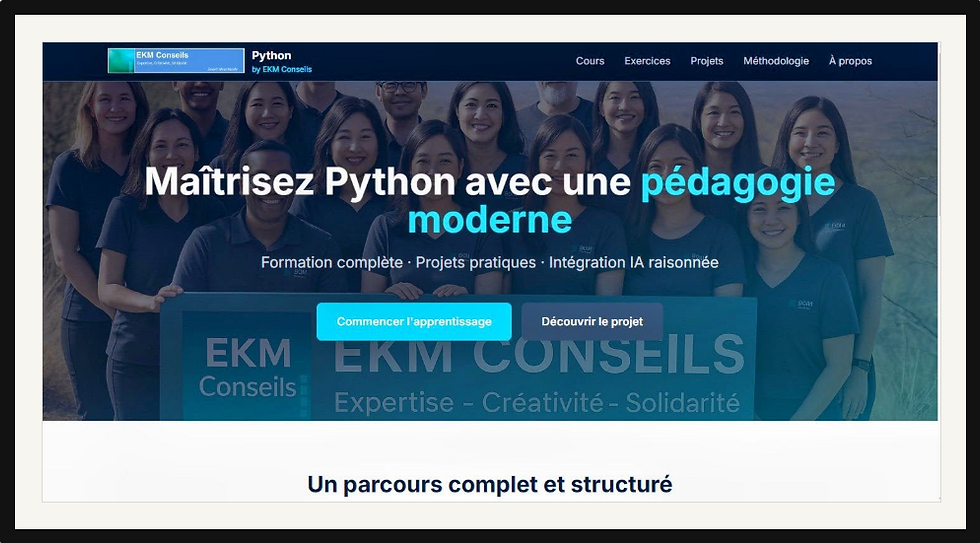

Comments